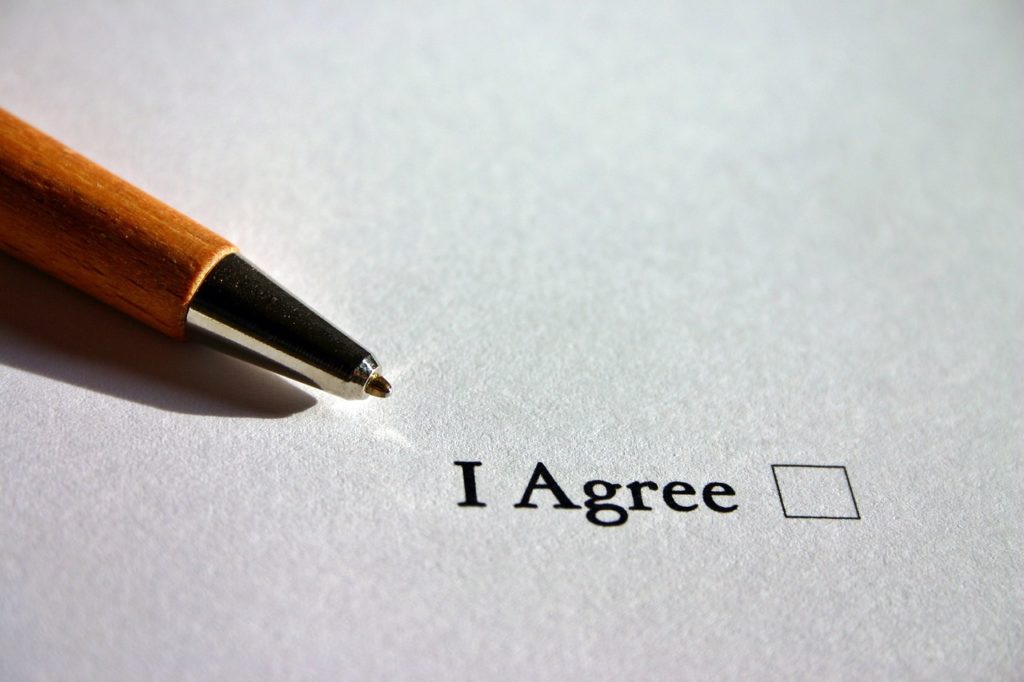Par un arrêt du 16 mai 2025 (CE, 16 mai 2025, n° 493143), le Conseil d’État rappelle qu’une rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé victime de harcèlement moral demeure valable, sauf si son consentement a été effectivement vicié.
Pour rappel, si la rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé est soumise aux conditions de droit commun (cas d’application, négociation de la convention, contenu, indemnité de rupture et délai de rétractation), elle doit être autorisée par l’inspecteur du travail, et non homologuée par le Dreets, ce qui implique, en cas de contentieux, la compétence du juge administratif, et non du juge judiciaire.
En l’espèce, une salariée protégée, membre du CSE, conclut une rupture conventionnelle avec son employeur, autorisée par l’inspection du travail début 2021. Quelques semaines plus tard, elle saisit le Conseil de prud’hommes, alléguant un vice du consentement lié à un contexte de harcèlement moral.
Le Conseil de prud’hommes sursoit à statuer, conformément à la règle selon laquelle la validité de l’autorisation de rupture relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Le tribunal administratif annule l’autorisation délivrée.
S’il écarte l’existence d’un lien entre la rupture du contrat de travail et le mandat du salarié protégé, il relève toutefois, d’une part, que la procédure de rupture conventionnelle est irrégulière et, d’autre part, que la signature de la rupture a eu lieu dans un contexte de harcèlement moral.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement, jugeant que les faits ont été inexactement qualifiés.
Il rappelle que l’inspecteur du travail doit vérifier que la rupture est conclue dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, que la procédure a été respectée, et qu’aucune pression, notamment en lien avec le mandat représentatif, n’a vicié le consentement du salarié.
Le Conseil d’État souligne que la seule existence d’un harcèlement moral ne permet pas, en soi, de conclure à l’irrégularité de la rupture : il faut encore démontrer un vice de consentement avéré.
Dans cette affaire, plusieurs éléments plaidaient contre une telle qualification : la salariée avait elle-même sollicité la rupture, était assistée par une avocate tout au long du processus, avait consulté le médecin du travail et participé à deux entretiens préalables. L’autorisation avait été régulièrement délivrée, et aucune pression n’a été objectivement démontrée. Le Conseil d’État précise que la présence de la DRH aux côtés de l’employeur n’est pas constitutive d’une contrainte, sauf preuve d’une influence déterminante sur le consentement du salarié.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence administrative (CE, 13 avr. 2023, n° 459213) et judiciaire (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-10.901), selon laquelle le harcèlement moral ne suffit pas à entacher la validité d’une rupture conventionnelle, sauf preuve d’un vice du consentement tel que défini aux articles 1130 et 1140 du Code civil.
Enfin, le Conseil d’État affirme exercer un contrôle de qualification juridique des faits plus poussé que celui de la Cour de cassation, qui laisse cette appréciation aux juges du fond. Il conclut ici à l’absence de vice du consentement, et valide en conséquence la décision de l’inspecteur du travail autorisant la rupture conventionnelle.