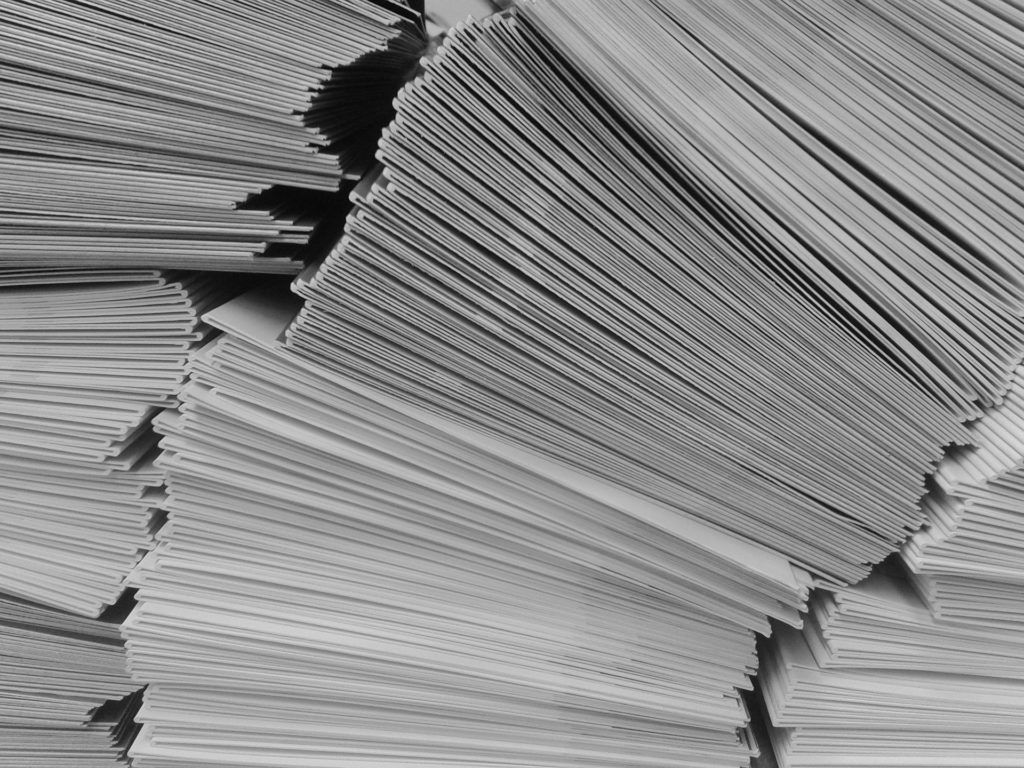Par un arrêt du 4 septembre 2025 (Cass. 2e civ., n° 22-17.437 FS-B), destiné à publication, la Cour de cassation a tranché une question sensible : un cotisant peut-il produire devant le juge des pièces qu’il n’a pas communiquées lors du contrôle Urssaf ou de la phase contradictoire ?
La Haute juridiction répond positivement, au nom du droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la CEDH, mais encadre ce principe par deux exceptions majeures liées aux spécificités de la procédure de contrôle.
Le principe
Le droit à un procès équitable implique que le cotisant puisse présenter, même tardivement, tous les éléments nécessaires au succès de ses prétentions. Les juges doivent pouvoir contrôler la matérialité des faits en disposant de l’ensemble des preuves utiles.
Dans l’affaire jugée, une association contestait un redressement Urssaf portant sur des contributions liées à un régime de retraite supplémentaire. Elle avait produit, pour la première fois devant le juge, une attestation non transmise lors du contrôle. L’Urssaf s’y opposait, arguant que de telles pièces devaient être fournies en temps utile aux agents de contrôle.
Les deux exceptions posées par la Cour
La Cour admet que le droit à la preuve doit être concilié avec les règles propres au système déclaratif des cotisations sociales, fondé sur le contrôle a posteriori. De là découlent deux limites :
- Pièces expressément demandées par les contrôleurs
Un cotisant ne peut pas produire devant le juge un document qui lui a été demandé lors du contrôle ou de la phase contradictoire, mais qu’il n’a pas fourni. Cette obligation découle de l’article R. 243-59 CSS, qui impose au contrôlé de mettre à disposition tout document jugé nécessaire. - Pièces que le cotisant devait conserver et produire spontanément
Lorsqu’il lui appartient de prouver la conformité de ses déclarations, le cotisant doit fournir les justificatifs pendant le contrôle, même sans demande expresse. À défaut, il ne pourra pas les produire pour la première fois devant le juge. Cela concerne notamment :
- les règles de déduction des frais professionnels ;
- la taxation forfaitaire (art. R. 243-59-4 CSS) ;
- l’évaluation forfaitaire en cas de travail dissimulé (art. L. 242-1-2 CSS) ;
- les tolérances administratives d’exclusion d’assiette (par ex. réductions tarifaires aux salariés).
Compatibilité avec la CEDH
Ces limitations sont jugées compatibles avec l’article 6 § 1 de la CEDH, dès lors que la procédure de contrôle Urssaf garantit déjà au cotisant un cadre contradictoire : droit d’être assisté, droit de répondre à la lettre d’observations dans un délai de 30 jours (prolongeable), obligation pour l’inspecteur de répondre à ses observations.
La Cour européenne des droits de l’Homme a elle-même admis que l’article 6 n’impose pas au juge de se substituer à l’administration, mais d’assurer un contrôle suffisant, en tenant compte des garanties offertes par la procédure administrative (CEDH, 6 nov. 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c/ Portugal).
Application à l’espèce
Dans le cas d’espèce, l’association contrôlée n’était pas dans une des deux hypothèses d’exclusion. Elle pouvait donc produire de nouvelles pièces au stade contentieux. Toutefois, les juges du fond ont estimé que l’attestation produite n’était pas pertinente car elle ne concernait pas le contrat objet du redressement. L’appréciation de la valeur probante des pièces reste donc souveraine.
Conclusion
Cet arrêt consacre un principe important : un cotisant peut en principe produire de nouvelles pièces en justice, même non fournies à l’Urssaf, mais il doit être vigilant. Les exceptions posées par la Cour rappellent qu’il est risqué de retenir des justificatifs pendant le contrôle dès lors qu’en principe, toute pièce demandée doit être fournie et toute pièce dont la charge de production incombe au cotisant doit être communiquée spontanément.
- En pratique, il reste fortement conseillé aux cotisants de présenter dès le contrôle toutes les pièces utiles afin de sécuriser leur défense et limiter le risque de redressement.